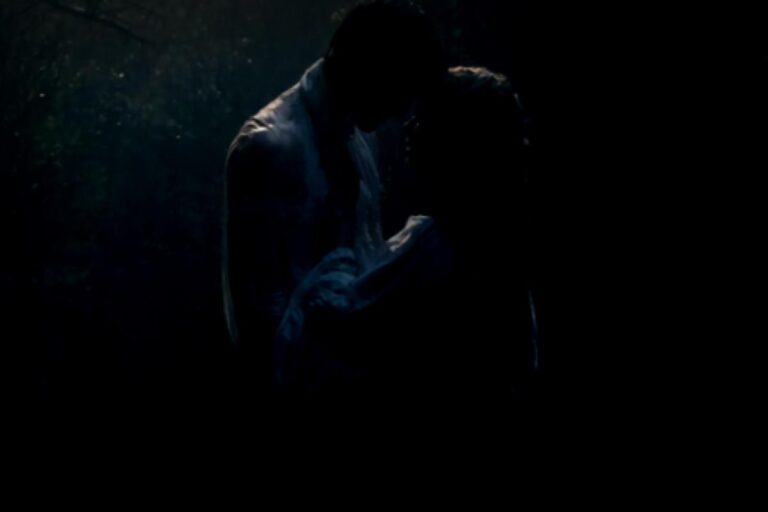Si l’on devait choisir un film représentatif du cinéma industriel de 2025, The Electric State, un blockbuster de science-fiction créé par Netflix à un coût exorbitant, serait un bon exemple, mais aussi un contre-exemple. Malgré un budget colossal, ce film, qui raconte une guerre entre humains et robots, peine à se faire une place, s’éteignant rapidement au sein d’une surabondance de contenu. Même avec un démarrage prometteur sur la plateforme, il n’a pas su captiver les spectateurs.
Ce cas décevant souligne une tendance croissante : l’essor des « films algorithmiques », pensés pour plaire à un large public au détriment de l’originalité. Des réalisateurs tels qu’Anthony et Joe Russo nous livrent des productions faciles à consommer – regardées un jour, oubliées le lendemain – accompagnées de scénarios simplistes comme des manuels d’utilisation pour le téléspectateur distrait.
Les titres des films Netflix sont souvent explicites : Tall Girl parle d’une fille grande, Uglies évoque une dystopie sur la chirurgie esthétique, etc. L’objectif est de garantir que tout le monde se sente rassuré, comme expliqué dans un article du Guardian, en mettant en avant des stars familières – sans cependant risquer de leur confier un poids commercial trop lourd. Ryan Reynolds, avec sa présence marquante, en est un exemple frappant.
Servir le dieu algorithme
Actuellement, Netflix compte près de 301 millions d’abonnés et produit plus de films originaux qu’Hollywood à son apogée. Cependant, bien que l’algorithme joue un rôle clé dans cette croissance, évaluer son influence réelle reste délicat. La plateforme prétend mêler créativité à l’analyse de données, mais très peu de voix au sein de l’entreprise se risquent à en parler ouvertement, craignant de froisser ce goliath qui est devenu indispensable pour l’industrie.
Tout débute à la fin des années 2000, lorsque Netflix révolutionne la classification des œuvres en instaurant des milliers de tags pour trier les contenus selon leurs thèmes, émotions ou tonalités. Cette méthode, plus fine que la simple catégorisation par genre, a tendance à amplifier les recommandations – jusqu’à parfois tomber dans la caricature avec des catégories hyper spécifiques inondant nos écrans en fonction des habitudes de visionnage de chaque utilisateur.
L’analyse des comportements des spectateurs prend progressivement une place prépondérante. L’algorithme accumule des milliards de données quotidiennement : ce que nous visionnons, à quel moment, sur quel appareil, et même combien de temps nous regardons un film avant de changer de programme. C’est cette stratégie qui arrête de financer certaines productions et en valorise d’autres.
Une culture anonyme
Cependant, l’algorithme ne décide pas tout : le processus repose encore sur un mélange de critères internes et d’intuition des studios, à la manière des méthodes de tests déjà en place à l’époque d’or du cinéma hollywoodien. Alors que le modèle de Netflix vise à capturer l’intérêt du public en moins de cinq secondes, il privilégie la sécurité, conformant ainsi le produit à ce qui est facilement accessible.
Ce formatage généralisé a cru lors de l’incroyable expansion de Netflix dans les années 2010, à une époque où la qualité a cédé la place à la quantité. On a alors vu émerger quelques films remarquables (Roma, Okja, etc.), noyés au milieu d’un océan de contenu sans personnalité, interchangeable, et souvent anodin.
À l’heure actuelle, face à une stagnation des abonnés et à une concurrence de plus en plus vive, Netflix resserre les budgets, opte pour une quantité maîtrisée et adapte son modèle. Le nouvel objectif est clair : produire des films attrayants, mais jamais trop originaux, afin de maintenir sa clientèle sans les surprendre avec des contenus novateurs.
Derrière la façade d’un répertoire illimité, l’algorithme construit une culture uniforme, appauvrissant l’industrie de ses sollicitations traditionnelles et modèles diversifiés. L’intégration de l’IA dans le processus de création pourrait encore accentuer cette tendance, soulevant des questions sur le rôle des artistes et sur le sens même de la création cinématographique.